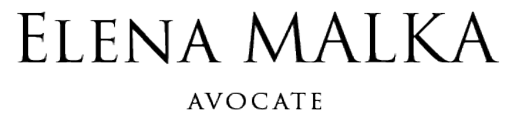1. De manière générale, la vulnérabilité de l’individu, qu’il soit majeur ou mineur, suppose qu’il puisse être atteint dans son intégrité1. L’état physique, psychique, voire économique, l’âge, la grossesse, la maladie de la personne pourront être des critères à prendre en considération pour évaluer l’état de la personne. En effet, le Code pénal a prévu ponctuellement des infractions autonomes ou même des circonstances aggravantes sanctionnant l’état de vulnérabilité de la victime2.
2. Le législateur a choisi d’aider, d’accompagner les personnes dont l’atteinte est suffisamment grave et pour une durée suffisamment importante. En contrepartie, leurs droits et libertés seront amoindris. L’article 425 du Code civil précise que pour justifier une mesure de protection, la personne doit être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. L’altération de ses facultés mentales, ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté devra être constatée par un médecin habilité3. Le juge des tutelles décidera d’une mesure de protection juridique par laquelle une tierce personne aidera et veillera aux intérêts du majeur protégé ou du mineur émancipé4. L’idée est alors de compenser les difficultés auxquelles le majeur est confronté, et de protéger ses intérêts personnels et patrimoniaux.
3. Malgré cela, cette évidence est curieusement teintée de controverses. La responsabilité du majeur protégé en matière civile a longuement évolué depuis la réforme du 5 mars 2007, en créant un meilleur équilibre entre la volonté de protection du majeur protégé et la reconnaissance de ses droits et libertés.
4. Corrélativement les choses sont différentes en matière pénale5. En effet, dans l’hypothèse où le majeur protégé commet une infraction, l’assistance par une personne habilitée qui lui est normalement réservée ne sera pas automatique. Cependant, il s’agit d’un mis en cause particulier en raison de ses prédispositions. Les droits de la défense doivent être renforcés à son égard, par la présence de son tuteur ou de son curateur et ce, à toutes les étapes procédurales, au risque que ce justiciable ne soit pas placé sur le même pied d’égalité qu’un mis en cause pourvu de toutes ses facultés. S’entremêlent alors droits fondamentaux, eu égard aux principes dégagés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, tels que la protection des droits de la défense, mais également le droit à un procès équitable, le droit constitutionnel, notamment concernant les décisions de QPC, et a fortiori le droit processuel face au statut particulier de ce majeur.
5. Le statut du majeur protégé poursuivi pénalement n’est actuellement affirmé que de façon incomplète (I), et une reconnaissance concrète est attendue pour pallier ce manque (II).
I. La reconnaissance incomplète du statut du majeur protégé soumis à une mesure pénale.
6. Seulement quelques points ayant été relevés par le Conseil constitutionnel ont été repris restrictivement par le législateur (A). Le Conseil constitutionnel essentiellement et la Cour de cassation continuent d’ailleurs ponctuellement à reconnaître certains droits au majeur protégé poursuivi pénalement (B).
A. L’acceptation restrictive du législateur du statut du majeur protégé
7. Il faut d’ores et déjà souligner que le rapport qui a précédé la réforme pour la justice du 23 mars 2019, concernant l’évolution de la protection juridique liée au statut des majeurs protégés et qui a dû être menée à la hâte, n’a fait que des remarques sommaires concernant les personnes vulnérables possiblement auteurs d’une infraction6. Aucune proposition finale n’a d’ailleurs été relevée concernant la matière pénale. Il a cependant été souligné dans l’unique page sur cent du rapport évoquant cette matière, que le mandataire désigné n’était que rarement informé des procédures en cours et que sa place n’était pas clairement identifiée. Puis la question a été renvoyée à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour approfondir les pistes évoquées.
8. Globalement, sur le plan civil la loi de programmation du 23 mars 2019 a renforcé les droits des personnes protégées en leur accordant davantage d’autonomie malgré une opposition possible de la personne responsable (droit de se marier, de divorcer, de se pacser etc.)7. Paradoxalement, spécifiquement concernant la matière pénale, le législateur s’est contenté de rectifier certaines des incohérences soulevées par le Conseil constitutionnel sans pour autant aller au-delà. Deux nouveaux articles, après l’article 706-112 du Code de procédure pénale ont été créés et l’article 706-113 dudit Code a été modifié.
9. Pour rappel, suite à une décision du 14 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, avait été inséré l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale, obligeant les services de police ou de gendarmerie, ou l’autorité sous le contrôle de laquelle se déroule la mesure de garde à vue, à prévenir le curateur ou le tuteur, si des éléments ont fait apparaître qu’une mesure de protection juridique avait été mise en place8. En effet, l’article 706-113 du Code de procédure pénale ne prévoyait aucun dispositif particulier en ce sens, nuisant irrémédiablement au droit de la défense et à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Encourt désormais la nullité de la procédure cette absence d’information dès lors qu’est apparu un élément indiquant un tel état de fait. Le problème est qu’antérieurement à la découverte d’une mesure de protection, des auditions pourront avoir eu lieu, le gardé à vue pourra avoir fait des déclarations spontanées sans en mesurer les conséquences. Par ailleurs, la forme pour prévenir la personne responsable, reste libre. En définitive, si les services de police ne contactent qu’une seule fois le responsable, et en imaginant que ces derniers ne laissent aucun message ou qu’ils n’attendent pas plusieurs sonneries avant de raccrocher, la procédure restera régulière, malgré l’absence de tentative concrète et réelle de le joindre. Il ne s’agit que d’une obligation de moyen et non de résultat. Il est regrettable que ce moyen n’ait pas été encadré légalement ce qui laisse une importante marge d’appréciation quant au contrôle de l’effectivité de cette obligation9. Par ailleurs, rien n’est textuellement précisé sur la recherche de l’état de vulnérabilité de la personne. Certes, l’article D15-5-7 du Code de procédure pénale précise que les services de police ou de gendarmerie doivent demander à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Cependant, rien ne garantit que la personne comprenne la question et qu’elle y réponde par l’affirmative.
10. En revanche, si cette étape est franchie, et que le mandataire est averti, il pourra demander à ce que la personne soit assistée d’un avocat et qu’elle soit examinée par un médecin si rien n’a été fait en ce sens. C’est dire à quel point il est indispensable d’avertir la personne responsable pour ne pas entacher les droits de la défense et plus généralement le droit à un procès équitable. Cette idée révèle l’importance d’appliquer de façon effective et concrète les droits affirmés dans la Cour Européenne des Droits de l’Homme auxquels l’Etat est soumis10. En définitive, ce raisonnement s’inscrit dans la juste lignée de la jurisprudence européenne11. Pour rappel, sans entrer dans de plus amples développements, son influence avait permis de créer les bases procédurales visant à encadrer les poursuites pénales à l’égard du majeur protégé12.
11. Ces principes sont toutefois sujet à des atténuations. En effet, en cas de circonstances insurmontables qui devront être dressées dans un procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs pour prévenir le responsable pourront être différées. Encore une fois, se pose la question des hypothèses qui pourront être qualifiées comme telles, ces dernières restant actuellement floues13. Il est à noter que l’imprévisibilité n’a cependant pas été retenue dans cette définition, ce qui augmente les possibilités d’exonération et d’atteinte au droit de la défense. Les circonstances insurmontables, qui se distinguent des circonstances particulières, n’ayant pas été textuellement définies, un long travail jurisprudentiel, à défaut d’une énième modification textuelle, reste à être parcouru pour que puisse être encadrée plus précisément cette situation. Fort heureusement, en cas de comparution immédiate, dès lors que le mandataire a été avisé de la mesure de garde à vue et de la date d’audience, l’exigence sera respectée14. Cependant, il faut encore que l’individu ait déclaré être contraint à une mesure de protection, ou qu’un doute ayant entraîné des vérifications sur son état aient lieu, ce qui reste aléatoire15. Il aurait été envisageable d’exclure les majeurs protégés d’un tel type de poursuite au même titre que les mineurs16.
12. De plus, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, à la demande d’un officier de police judiciaire, différer, voire supprimer cet avis en cas de circonstances indispensables à la conservation des preuves, ou pour éviter une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne17. Il est quelque peu complexe de comprendre en quoi l’avis du tuteur ou du curateur pourrait entraver l’enquête, sauf dans l’hypothèse où ce dernier serait lui-même impliqué, et dans ce cas il serait toujours possible de désigner un mandataire spécial pour assister le majeur. En effet, la personne qui n’est pas assistée par un tuteur ou un majeur, ne saurait être placée sur le même pied d’égalité qu’une personne pourvue de toutes ses capacités et mise exactement dans la même situation. Un déséquilibre apparaît alors, nuisant corrélativement ouvertement au droit de la défense.
13. Enfin, le délai pour accomplir les diligences pourra aller jusqu’à 6 heures sachant que la garde à vue n’est normalement que de 24 heures. Durant près d’un quart du temps de la garde à vue, le majeur protégé pourra alors s’exprimer, faire des déclarations et ce sans être accompagné par son responsable. Il est regrettable qu’un tel laps de temps soit accordé pour prévenir son curateur ou son tuteur.
14. De manière générale, il a été décidé que la lecture des droits du gardé à vue serait à titre expérimental enregistré et filmé dans certains commissariats et gendarmeries18. Pareillement, il serait possible de vérifier comment est demandé au gardé à vue s’il est soumis à une mesure de protection, de vérifier les réponses et d’analyser les diligences accomplies par les enquêteurs en vue d’informer le mandataire. Cela permettrait a fortiori de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la vérification de l’état ou non de vulnérabilité du mis en cause.
15. L’article 706-112-2 du Code de procédure pénale a également renforcé les droits des majeurs protégés entendus librement. Dans la même logique que précédemment, lors d’une audition libre, ce n’est que si les éléments recueillis font apparaître qu’a été mise en place une mesure de protection juridique, qu’il faudra informer la personne responsable. Actuellement, les décisions sont conservées au greffe du tribunal judiciaire, voire au greffe du juge des tutelles, ou au service central de l’état civil, qui ne sont pas accessibles en dehors des horaires d’ouverture19. Qu’il s’agisse d’une audition libre ou d’une mesure de garde à vue, il est important que la décision de tutelle ou de curatelle soit consultable à tout moment. La garde à vue, en tant que mesure de contrainte, étant réduite dans le temps, peut avoir lieu de jour comme de nuit. Il est alors préférable que cette information soit accessible plus aisément par les services de police et de gendarmerie20.
16. De plus, il faut souligner que l’information de la personne responsable en cas d’audition libre ne s’impose que lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue. D’abord, il est important de rappeler qu’une contravention reste une peine. En droit pénal il est exclu de raisonner par analogie. Cependant, il est possible de souligner qu’il ne serait pas concevable d’entendre une personne ivre puisque dépourvue de ses pleines capacités physiques et mentales. Similairement, la présence du tuteur ou du curateur compense les difficultés auxquelles est assujettie la personne vulnérable, donc sa présence doit être constante et ce aux divers stades de la procédure.
17. Ensuite, même si le rôle du tuteur ou du curateur ne saurait remplacer celui de l’avocat, l’individu étant, encore une fois, dépourvu de ses pleines capacités puisque non assisté par la personne dont il dépend, il pourrait être amené à évoquer d’autres faits, sans en mesurer les conséquences. Fort heureusement, ces seules déclarations ne sauraient suffire à une condamnation mais elles conduiront inévitablement à des investigations. Pire encore, il pourrait renoncer à son droit d’être assisté d’un avocat, puisqu’il ne s’agit que d’une possibilité et non d’une obligation.
18. Enfin, la loi de programmation a modifié l’article 706-113 du Code de procédure pénale, obligeant le procureur de la République, ou le juge d’instruction à avertir la personne responsable, dès que le mis en cause est poursuivi. En d’autres termes, il faut que la personne responsable ait été avisée de cette information, et non qu’ils aient préalablement vérifié cet état de fait. Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation est venue préciser qu’en cas de doute sur l’état du majeur, des vérifications devaient être faites21. Là encore, le doute reste intrinsèque à l’enquêteur et de même qu’a fortiori la vérification de l’état de la personne.
19. Le Conseil constitutionnel, dans le droit-fil des principes rappelés constamment par la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment le respect des droits de la défense, comme la Cour de cassation ne se sont pas contentés de cette modification législative.
B. La légitimation ponctuelle par la jurisprudence du statut du majeur protégé
20. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a, postérieurement à la loi de programmation du 23 mars 2019 et de réforme pour la justice, considéré contraire à la Constitution l’absence de disposition spécifique permettant de vérifier le consentement des majeurs protégés faisant l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire22. Pour rappel, l’article 76 du Code de procédure pénale impose de recueillir l’assentiment de l’intéressé, sauf exception, avant toute entrée dans son domicile, et ce en raison du principe d’inviolabilité du domicile23. Cependant, aucune disposition légale n’imposait aux policiers de vérifier si la personne était soumise à une mesure de protection. L’assentiment exprès de la personne protégée ne saurait être logiquement admis, cette dernière étant dépourvue de ses pleines capacités. Ce n’est qu’en présence de son mandataire que l’équilibre pourra être rétabli et également que le doute sur la compréhension et sur l’acceptation ou le refus que soit effectuée la perquisition pourra être levé24. A contrario, la Cour de cassation est récemment venue préciser que l’absence d’information, en l’espèce de la curatrice, en cas de perquisition n’entrainait pas automatiquement la nullité du réquisitoire introductif25. Il a été précisé que, dès lors qu’aucun interrogatoire n’avait eu lieu, que l’authenticité des biens n’avait pas été remise en cause, que les enquêteurs n’avaient pas eu connaissance d’une telle mesure, la perquisition n’était pas nulle. Sur ce dernier point, la problématique reste constante puisque cet état de fait justifiera systématiquement une absence du curateur ou du tuteur, donc une atteinte au droit de la défense.
21. Ensuite, en matière d’exécution des sentences, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée, en raison de l’absence d’information du tuteur ou du curateur pour assister la personne protégée devant le juge d’application des peines26. A ainsi été jugé inconstitutionnel l’article 712-6 du Code de procédure pénale qui avait méconnu cette hypothèse. Il faut de même souligner, cette fois-ci, la réactivité du législateur qui a créé avant la décision de censure, l’article 712-16-3 du Code de procédure pénale visant à pallier l’inconstitutionnalité soulevée27. Désormais la date du débat contradictoire devra avoir été communiquée au mandataire, et ce dernier sera à même de faire des observations écrites, ou être entendu comme témoin sur décision du président de la juridiction d’application des peines. La présence de l’avocat est bien entendu obligatoire à l’inverse de celle du mandataire. En effet, encore une fois, il ne s’agit que d’un devoir d’information et non de présence de la personne qui pourtant est amenée à constamment prendre les décisions importantes dans la vie de la personne protégée. En matière pénale, cette dernière n’agit que dans l’ombre puisque sa présence n’est pas systématiquement requise.
22. Par ailleurs, il faut noter que la Cour de cassation intervient également pour renforcer ponctuellement les droits des majeurs protégés. Il est à noter qu’il est textuellement prévu que toute personne étant sous protection juridique et étant poursuivie pénalement doit être soumise à une mesure d’expertise médicale28. Cependant la sanction, en cas d’inobservation des règles prévues, n’était pas clairement énoncée. La Cour de cassation est alors venue indiquer que c’est à peine de nullité que la personne soumise à une mesure de protection doit être expertisée29. L’idée est de vérifier si au moment des faits, l’état de la personne ne s’était pas dégradé et si elle n’était pas irresponsable pénalement à ce moment précis. Il est utile de préciser que cette idée ne s’applique pas aux contraventions. Objectivement, le coût serait exorbitant si une expertise devait être effectuée dès qu’une personne protégée se rendait coupable d’une contravention, même si le seul argument pécuniaire reste difficilement acceptable. Par ailleurs, dans les contraventions, l’élément moral importe peu, sauf exception30. Cette idée est déduite de l’article 121-3 du Code pénal qui indique que la seule hypothèse où il n’y a pas de contravention résulte de la force majeure31. Par ailleurs, la faute doit être consciente et éclairée et elle ne saurait être admise en cas d’aliénation mentale. La personne protégée n’en est pas à ce stade, elle reste donc responsable des infractions qu’elle commet.
23. De plus, il convient de rapporter un arrêt où la chambre criminelle est venue rappeler l’importance d’aviser des poursuites dont la personne protégée fait l’objet, le curateur ou le tuteur32. Pour rappel, l’article 706-113 du Code de procédure pénale prévoit d’aviser le tuteur ou le curateur, en cas de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation, mais elle n’a pas précisé que tel était le cas lorsque la personne est interrogée puis mise en examen. L’article 173-1 du Code de procédure pénale, prévoit quant à lui un délai de forclusion de 6 mois à compter de la notification de la mise en examen pour présenter une requête en nullité concernant les actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou lors de cet interrogatoire lui-même. Cependant, l’arrêt commenté est venu préciser que dès lors que l’état de la personne est connu, le délai permettant de révéler une nullité ne peut commencer à courir, cette dernière n’étant pas en mesure, en l’absence de son tuteur ou de son curateur, d’en entrevoir l’existence.
24. Enfin, il convient de souligner de manière générale, un mouvement important concernant le droit de se taire, qui s’intensifie positivement pour la personne concernée33. Ce droit qui s’incorpore au droit à un procès équitable en juste application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, peut être exprimé par la personne poursuivie mais il n’est pas systématiquement rappelé34. Cet état de fait cause obligatoirement un grief au mis en cause, sauf dans l’hypothèse où il aurait été préalablement notifié notamment en cas de réouverture des débats35. Concernant les majeurs protégés, la confusion peut être davantage marquée, puisque la possibilité de faire des observations n’est qu’une hypothèse qui ne suppose pas inéluctablement le droit de se taire. Le Conseil constitutionnel est d’ailleurs venu renforcer cette possibilité en déclarant inconstitutionnel l’article 394 du Code de procédure pénale, qui ne prévoyait pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention devait être informé de cette prérogative36. Etant précisé que l’abrogation des dispositions concernées est cependant reportée au 31 mars 2022. Le droit de se taire et de garder le silence avait antérieurement été rappelé par la haute juridiction, imposant une obligation d’information du droit de se taire lors d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental37.
25. En définitive, malgré l’intention louable du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation de toujours mieux assurer les droits du majeur protégé en juste application des principes dégagés par le droit européen, il serait cependant grand temps que le législateur intervienne de façon générale. Cela permettrait d’éviter de nuire au principe d’exigence de clarté de la loi.
II. La reconnaissance expectative du statut du majeur
protégé soumis à une mesure pénale
26. Pour un juste respect des droits fondamentaux, et notamment des droits de la défense, le législateur doit intervenir pour inscrire dans le marbre les évolutions essentielles et nécessaires aussi bien antérieurement à la condamnation du majeur protégé (A) que postérieurement (B).
A. Les évolutions essentielles antérieurement à la condamnation du majeur protégé
27. A titre liminaire, il faut indiquer que les textes n’imposent pas une présence constante du tuteur ou du curateur lors des poursuites, de l’instruction et du jugement. Pourtant, la Cour de cassation comme sus-évoqué est venue rappeler que la personne désignée incapable juridiquement est dans l’incapacité d’exercer ses droits, en l’absence de discernement, et elle peut même être dépourvue de la capacité d’exprimer sa volonté38. Il aurait été plus aisé d’imposer la présence de la personne responsable du majeur protégé à tous les stades de la procédure et ce, à peine de nullité. Cette solution semble évidente dès lors que l’absence des pleines capacités du majeur protégé n’est plus compensée par la présence du mandataire. Le législateur n’a cependant pas choisi d’aller dans ce sens, et ce au risque d’une nouvelle condamnation de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme39. En conséquence, le Conseil constitutionnel doit faire face à une frénésie florissante de QPC qui anime désormais les prétoires40.
28. Par ailleurs, il faut indiquer que dans l’hypothèse où le curateur ou le tuteur est présent à l’audience il sera entendu en qualité de témoin41. Pour rappel, le témoin prête serment de dire la vérité. Il est alors curieux que le mandataire soit à la fois responsable de la personne et potentiellement à charge en raison de l’obligation qui pèse sur sa personne42. En effet, le refus de prêter serment peut engendrer une amende d’un montant maximum de 3750 euros, et le faux témoignage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros43. Cependant, l’article 226-13 du Code pénal sanctionne la révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire, de par son état, sa profession ou sa fonction, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il ne semble pas à l’heure actuelle que le curateur ou le tuteur rentre dans cette hypothèse44. Ce statut hybride n’est pas acceptable et le rôle de la personne responsable doit être dédié exclusivement aux intérêts du majeur protégé.
29. Concernant le majeur protégé ce dernier peut également être auditionné en tant que témoin45. Le problème est qu’il peut être amené à s’auto-incriminer puisqu’il n’est pas, dans une telle hypothèse, assisté ni de son représentant ou d’un avocat. Dans un cas d’espèce, une personne sous curatelle avait indiqué lors d’une audition en tant que témoin simple, que son père avait la volonté de tuer une tierce personne et qu’il lui avait demandé de l’aide. L’individu avait été amené à confirmer ses dires devant le juge d’instruction. La Cour de cassation avait alors censuré la décision en rappelant que le juge d’instruction devait se limiter à la vérification sommaire des faits46. La question de la limitation du champ d’action des enquêteurs, quant aux questions qu’ils peuvent être amenés à poser, avait été laissée en suspens. S’il est acceptable qu’un témoin ordinaire, pourvu de ses pleines capacités ne bénéficie pas des droits de la défense, il en est autrement concernant un majeur protégé. Il aurait été opportun lors de la réforme du 23 mars 2019 ayant renforcé les droits des majeurs protégés, d’exiger que soit informé mais également présent le tuteur ou le curateur et ce même pour une simple audition. En effet, l’audition, même en tant que témoin simple par les services de police ou de gendarmerie pourrait s’avérer déroutante pour une personne soumise à une mesure de protection et elle pourrait être amenée à faire des déclarations inopportunes à l’encontre de ses propres intérêts, voire à s’auto-incriminer.
30. Sans redondance avec ce qui a été préalablement évoqué, il est regrettable que l’expertise médicale, qui constitue une formalité substantielle, permettant de déterminer si la personne était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ne soit obligatoire que pour les crimes et les délits47. Dans ce dernier cas en effet il ne s’agit pas là de vérifier si la personne est en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants de la procédure dont elle fait l’objet. Elle reste facultative pour les procédures alternatives, pour la composition pénale, pour le témoin assisté, pour l’ordonnance pénale et même pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité48. Concernant les contraventions elle reste exclue. Dans la même logique d’ailleurs, l’avis de l’objet et de la date d’audience du responsable par le ministère public n’est obligatoire que pour les crimes, les délits, et pour les contraventions de cinquième classe49. En pratique, cela peut entraîner des difficultés pour le tuteur ou le curateur. En effet, si ce dernier n’a pas été avisé d’une, voire de plusieurs contraventions, des majorations pourront s’appliquer. Pire encore, l’absence de paiement peut entraîner une convocation devant le tribunal de police. L’article 706-113 du Code de procédure pénale indique que le procureur de la République doit informer le tuteur ou le curateur des poursuites dont le majeur protégé fait l’objet ; il est alors possible de penser que tel doit également être le cas devant le tribunal de police, encore faut-il qu’il ait été informé de cet état de fait. Il est également prévu qu’en cas d’alternative aux poursuites de composition pénale, ou de comparution préalable de culpabilité il en sera de même. Les ordonnances pénales n’ont en revanche curieusement pas été incluses. S’il était possible de penser que cette procédure a été exclue en raison de la reconnaissance des faits, de la simplicité de l’affaire, in fine il aurait dû en être de même pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité or tel n’est pas le cas.
31. Ainsi, pour faciliter l’ensemble de la procédure pénale, au bénéfice des différents acteurs l’organisant, il serait nécessaire de créer un fichier national auquel ils auraient accès pour permettre de vérifier systématiquement l’état des personnes, mais également les nom et l’adresse de la personne responsable de la personne vulnérable50. Cela serait bénéfique pour les services de police et de gendarmerie qui seraient plus à même de prévenir les personnes responsables sans avoir à effectuer des recherches chronophages. La même logique s’appliquerait bien entendu aux magistrats51. Cela faciliterait le respect des droits de la défense mais pas seulement. En effet, cela serait bénéfique également pour les victimes, pour qu’elles soient mieux accompagnées. Il est à regretter que le juge des tutelles ainsi que le greffe du tribunal judiciaire en charge du répertoire civil, soient les seuls détenteurs des informations concernant la personne protégée comme l’a souligné la Cour de cassation52.
32. Enfin, il est également à regretter que le majeur protégé puisse s’entretenir avec son tuteur ou son curateur, lors d’une mesure de garde à vue, uniquement si l’officier de police judiciaire a donné son accord et non de façon automatique53. Seule devrait pouvoir justifier un refus, une implication possible de la personne en charge du majeur protégé. La personne pourrait être amenée à se sentir contrainte d’avouer des faits, simplement pour pouvoir s’entretenir avec la personne chargée de ses intérêts, qui est fréquemment une personne proche de son entourage. Pourtant le Code civil a prévu que le mandataire assiste la personne pour se défendre54. Il semble que cette contrainte soit allégée lorsque la personne est poursuivie pénalement, alors même que les intérêts en jeu peuvent être capitaux. Il serait également préférable que le droit de faire prévenir son tuteur ou son curateur soit intégré à la notification des droits prévue par l’article 63-1 du Code de procédure pénale, sans qu’il soit nécessaire d’attendre de se rendre compte que la personne est potentiellement placée sous un régime de protection.
B. Les changements nécessaires postérieurement à la condamnation du majeur protégé
33. Il est à regretter que le législateur n’ait pas anticipé les diverses censures du Conseil constitutionnel sus-évoquées. Il l’est encore davantage, puisque ces multiples sonnettes d’alarme n’ont pas incité le législateur à mener une réflexion d’ensemble pour assurer une protection pérenne des droits fondamentaux des majeurs protégés et ce à toutes les étapes de la procédure. L’absence de temps pour étudier les failles concernant les droits des majeurs protégés soumis à des poursuites pénales, relevées dans le rapport interministériel de 2018, n’a pas incité le législateur à s’y atteler pour éluder les interrogations pendantes55. Le renvoi à la chambre criminelle de la Cour de cassation, alors même que cette mission ne relève pas de ses prérogatives, était trop aisé. Il n’est pas nécessaire de rappeler plus en détail que son pouvoir d’interprétation ne saurait interférer avec le pouvoir législatif. Quoi qu’il en soit, l’absence de prise en considération réelle du pouvoir législatif d’un statut pénal particulier pour le majeur protégé entraine parallèlement une augmentation significative des questions prioritaires de constitutionnalité. Il est alors nécessaire, plutôt que d’agir ponctuellement, et de geler les audiences en cours, d’avoir une réflexion d’ensemble sur le majeur protégé. Pire encore, l’ensemble des mesures prescrites par les articles prévus ne sont pas clairement et systématiquement établies à peine de nullité56. Cela laisse à penser que les personnes incarcérées soumises à une mesure de protection, alors même qu’aucune mesure spécifique n’a été prévue ne sont pas prêtes d’entrevoir une amélioration de la prise en considération de leurs statuts.
34. En effet, un regard primitif porté sur la table alphabétique du Code de procédure pénale permet de s’apercevoir que peu de renvois à des textes sont formulés concernant les termes « majeurs protégés ». L’ensemble des renvois se trouve au titre vingt-sept du Code de procédure pénale, intitulé « de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés ». Cet état de fait laisse à penser qu’en prison cet état n’a plus à être considéré. En revanche, le Code de procédure pénale, a cependant pris le soin d’exclure ces personnes des jurés d’assise57. La rapporteuse de l’ONU a pourtant considéré cela comme contraire à l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La vulnérabilité en droit interne semble à géométrie variable58.
35. Antérieurement à la condamnation, il faut souligner que le tuteur ou le curateur bénéficie d’un permis de visite de la personne condamnée et qu’il ne peut leur être retiré qu’en cas d’implication aussi bien en tant qu’auteur que victime dans les faits reprochés59. Fort heureusement, postérieurement à la condamnation le tuteur, le curateur ou la personne désignée, bénéficient également d’un permis de visite plein droit60. Cependant ce permis de visite peut dans certaine hypothèse être, interrompu, suspendu ou retiré61. Si la décision peut être justifiée rien n’est dit concernant l’absence de suivi du majeur protégé, dans l’attente d’une nouvelle personne responsable à son égard, et du caractère urgent relatif à l’absence de suivi durant la désignation d’un nouveau mandataire.
36. De plus, de manière générale il faut rappeler qu’il existe plusieurs régimes de protection. Il peut s’agir de la tutelle pour les personnes les plus dépendantes, de la curatelle où la personne reste indépendante pour des actes simples de la vie, mais il existe également d’autres régimes62. Il y a également la sauvegarde de justice, qui est une mesure de courte durée, intermédiaire, entre soit le rétablissement de la personne, soit un placement sous une mesure plus restrictive précédemment citée. L’habilitation familiale vise quant à elle à protéger la personne via une personne de la famille. Elle est également spécifiquement envisagée pour la représentation d’un conjoint. Pourtant, qu’il s’agisse des mesures prévues antérieurement à la condamnation de la personne, ou postérieurement, l’ensemble de ces régimes de protection n’est pas intégralement abordé63. En effet, l’article 706-112 du Code de procédure pénale renvoi au titre XI du livre 1er du Code civil concernant les majeurs protégés. Pourtant, les articles suivants n’évoquent pas la personne sous habilitation, mais simplement la personne sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. Pire encore, les personnes incarcérées et soumises à l’une de ces mesures, qui pour rappel ont un lien avec une altération physique, psychique et/ou mentale, seront soumises au régime de droit commun et aucune mesure particulière et adaptée à chaque régime n’est prévue.
37. Par ailleurs, il n’existe pas de quartier spécifique au sein de la prison pour les majeurs protégés. Il n’existe pas non plus de contrôle médical particulier les concernant. Des mesures particulières pour les détenus malades sont prévues, cependant certaines personnes vulnérables ne nécessitent pas de traitement médical spécifique, mais simplement un accompagnement adapté. Pourtant, la prison peut avoir un impact important sur le comportement des auteurs d’infractions, qui peut s’amplifier chez les personnes vulnérables64. Pire encore, certaines personnes détenues peuvent être amenées à ne pas révéler leur état de vulnérabilité. A l’instar du dossier pénal numérique, ou du fichier national des casiers judiciaires, il serait grand temps de créer un fichier national qui serait accessible également aux services pénitentiaires. La Cour de cassation avait d’ailleurs souligné que l’absence de ce recensement, additionné à d’autres effets, était constitutif d’une circonstance insurmontable, susceptible de légitimer l’absence d’information du tuteur65. En définitive, le majeur vulnérable ne se trouve donc pas correctement protégé, puisque l’absence d’information sur cet état de fait pourra entraîner l’absence de prise en considération particulière. L’enfermement doit être strictement nécessaire, et il l’est d’autant plus pour les personnes atteintes d’un trouble psychique et/ou physique. De surcroît, il est important de veiller à ce que la peine ne devienne pas un traitement inhumain et dégradant.66
38. Enfin, il peut s’avérer difficile pour le majeur protégé de comprendre les tenants et les aboutissants de sa peine, de sa réinsertion, de sa sortie, des éventualités de son aménagement de peine, de sa libération sous contrainte, sans un accompagnement particulier. Fort heureusement, globalement les services pénitentiaires d’insertion et de probation accompagnent les détenus aussi bien en milieu fermé qu’en milieu semi-fermé et ouvert67. Cependant, l’effectivité des mesures, au regard de la surpopulation carcérale peut parfois faire défaut68. Il est alors regrettable que le mandataire ne puisse voir le majeur protégé que lors de visites ponctuelles. La nécessité est qu’il puisse l’accompagner de façon plus active, grâce à des visites moins limitées, ou à des appels téléphoniques plus fréquents. Il est également nécessaire d’accorder au mandataire le droit de faire une demande de mise en liberté pour le compte de la personne protégée. En effet, si la réforme du 23 mars 2019 a effectivement renforcé l’autonomie des majeurs protégés au niveau des actes courants de la vie civile de l’individu, aucune corrélation, s’apparentant à une diminution des pouvoirs de son tuteur, son curateur, ou son mandataire spécial ne doit être faite au niveau pénal, tant les enjeux sont importants. En définitive, la présence de l’avocat, des services pénitentiaires d’insertion et de probation doit nécessairement se conjuguer avec l’accompagnement du mandataire.
Notes :
- T. DEBARD, S. GUINCHARD, Lexique des termes juridiques , 2021, Dalloz, p. 1095. ↩︎
- J. PRADEL, « Brèves remarques sur la vulnérabilité, un concept moderne en droit pénal », in Mélanges en l’honneur du doyen R. BERNARDINI , parcours pénal, 2017, l’Harmattan, p. 213 ; F-X ROUX-DEMARE, « La notion de vulnérabilité », approche juridique d’un concept polymorphe, les cahiers de la justice, 2019, p. 619. ↩︎
- 415 à 515 CC. ↩︎
- F.ARBELLOT, N. PETERKA, A. CARON-DEGLISE, Protection de la personne vulnérable , Dalloz action, 2021, n°03.22, p. 38 et s. ↩︎
- JCI Civil Code, art. 415 à 432, fasc. 10, A. Batteur. ↩︎
- Rapp. mission interministérielle, A. CARON DEGLISE, « L’évolution de la protection juridique des personnes », 2018. ↩︎
- L. n°2019-222 23 mars 2019 de programmation et 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO n°0071 24 mars 2019 ; I. Maria, « Loi de programmation et de réforme pour la justice-Personnes protégées, protection juridique des majeurs : une nouvelle réforme dans l’attente d’une autre ? », Dr. famille 2019. dossier 15 ↩︎
- Cons. const. 14 sept. 2018, n° 2018-730 QPC, D. actu. 21 sept. 2018, obs. S. FUCINI ; D. 2018, p. 1757 ; D. 2019, p. 1248, obs. E. DEBAETS et N. JACQUINOT ; Constitutions 2018, p. 454. ↩︎
- E. BONIS, V. PELTIER, « Chronique de droit pénal et de procédure pénale », Titre VII, vol. 2, n°1, 2019, p. 92-103. ↩︎
- F. SUDRE, H. SURREL, « Droits de l’homme », rép. internat., 2020, n°80. ↩︎
- CEDH, 30 janv. 2001, req. n°35683/97, Vaudelle c/France, JCP 2001, p. 342, n°14, obs. SUDRE ; JCP 2001, II, p. 10526, n. DI RAIMONDO ; D. 2002, p. 353, n. GOUTTENOIRE-CORNUT, RUBI CAVAGNA ; D. 2002, somm. p. 2164, obs. LEMOULAND : JCP 2001, II, P. 10526, n. DI RAIMONDO ; Dr. fam. 2001, n°66, obs. FOSSIER ; LPA 19 nov. 2001, n. MASSIP ; RTD civ. 2001, p. 330, obs. Hauser. ↩︎
- L. n°2007-293 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, art. 37, JO n°55, 6 mars 2007. ↩︎
- V. TELLIER-CAYROL, « L’assistance du majeur protégé, placé en garde à vue, encore un effort », D. 2019, p. 124. ↩︎
- Crim. 19 sept. 2017, n°17-81.919, D. 5 oct. 2017, no 33; Crim. 11 déc. 2018, no 18-80.872, D. actu. 14 janv. 2019, obs. M. RECOTILLET ; Crim. 8 juin 2016, no 15-85.196. ↩︎
- V. Tellier-Caryrol, l’assistance du majeur protégé placé en garde à vue, encore un effort, art. préc. ↩︎
- L423-5 CJPM. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Décr. n° 2019-1421 20 déc. 2019, portant application de l’article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO n°0297 22 déc. 2019. ↩︎
- D. NOGUERO, « Pot-pourri de procédure pénale concernant les majeurs protégés », LPA, 9 juill. 2019, p. 15. ↩︎
- Vf. Infra IIA. ↩︎
- Crim. 19 sept. 2017, n°17-81.919, D. actu. 18 oct., 2017, obs. Benelli-de-Bénazé, AJ pén. 2017, p.504, obs. Lasserre Capdeville ; RSC 2017, p. 771, n. Cordier. ↩︎
- Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-873 QPC, D.actu. 27 janv. 2021, obs. D. GOETZ ; D. 2021 p. 619, et les obs. , n. V. Tellier-Cayrol. ↩︎
- A. CAPPELLO, « Question prioritaire de constitutionnalité », rép. pén., 2021, n°268. ↩︎
- N. RIAS, « Enquête préliminaire et perquisition chez un majeur protégé : inconstitutionnalité du régime actuel », AJ pén. 2021, p.160 ↩︎
- Crim. 11 mai 2021, no 20-82.267, D. actu. 8 juin 2021, obs. H. DIAZ ; AJ Fam. 2021, p. 440. ↩︎
- Cons. const. 12 févr. 2021, n°2020-884 QPC, D. act. 18 févr. 2021, obs. D GOETZ ; D. 2021, p.286 ; AJ Fam. 2021, p. 240, obs. V. MONTCOURCY ; AJ pén. 2021, p. 168 ; Dr. pénal 2021, étude 9, E. BONIS. ↩︎
- L. n°2020-1672 24 déc. 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, art. 27, JO n°0312 du 26 déc. 2020 ↩︎
- 706-115 CPP. ↩︎
- Crim. 16 déc. 2020, n°19-83.619, D. actu. 15 janv. 2020, obs. DOMINATI. ↩︎
- Vf. : en matière douanière : Crim. 20 févr. 1997, n°95-84.764. ↩︎
- C. COURTIN, « Contravention », rép. pén., 2010, n°37 et s. ↩︎
- Crim 22 juin 2021, n°21-80.407 B, D. 2021, p. 1564, obs. PERRIER. ↩︎
- M. RECOTILLET, « L’avis de la Cour de cassation sur le droit de se taire au cours des débats sur la détention provisoire », D. actu. 15 mars 2021. ↩︎
- 14 mai 2019, n° 19-81.408, D. actu. 6 juin 2019, obs. FUCINI ; D. 2019 p. 1050 ; AJ pén. 2019., p. 390, obs. MIRANDA. ↩︎
- L. PRIOU-ALIBERT, « De la notification du droit de se taire lors de l’audience correctionnelle », D. actu.28 juin 2021. ↩︎
- Cons. const. 30 sept. 2021, n°2021-935, QPC, D. actu. 7 oct. 2021, obs. GOETZ. ↩︎
- Crim. 8 juill. 2020, n°19-85.954, D. actu. 7 sept. 2015, obs. RECOTILLET ; AJ pén. 2020, p. 414,obs. THIERRY ; RSC 2020, p. 686, obs. DELAGE. ↩︎
- Cons. const. 14 sept. 2018, n°2018-730 QPC, cit. préc. ↩︎
- CEDH, 30 janv. 2001, req. n°35683/97, Vaudelle c/France, préc. ↩︎
- F. ARBELLOT, N. PETERKA, A. CARON-DEGLISE, Protection de la personne vulnérable , op.cit., n°241-34. ↩︎
- 706-133 CPP ↩︎
- L. MICHEL, De la régressivité de la volonté dans la protection des majeurs , th. ss. direct. S. PELLET, 2016, p. 366, n°574 et s. ↩︎
- 326, 434-13 CPP. ↩︎
- D. POLLET, « Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs face au secret professionnel », RDSS, 2013, p. 711. ↩︎
- D47-15 CPP. ↩︎
- Crim. 8 juin 2017, n°17-80.709, D. 2019, p. 1252, AJ pén. 2017, p. 406, obs. OUDOUL. ↩︎
- 706-115, D47-21, D47-22 CPP. ↩︎
- D47-22 CPP ; C. Roth, « Le majeur protégé visé par une accusation en matière pénale : neuf années de construction jurisprudentielle », AJ Fam. 2016, p. 247. ↩︎
- D47-20 CPP. ↩︎
- Rapport annuel, Cour de cassation , la documentation française, 2018, p. 121 et s. ↩︎
- 706-113 CPP. ↩︎
- Crim. 11 déc. 2018, no 18-80.872, D. actu. 14 janv. 2019, obs. M. RECOTILLET. ↩︎
- 63-2, D47-14 CPP. ↩︎
- 468 CC. ↩︎
- Rapp. mission interministérielle, l’évolution de la protection juridique des personnes, 2018. ↩︎
- F. ARBELLOT, N. PETERKA, A. CARON-Déglise, Protection de la personne vulnérable , op. cit., n°241.41. ↩︎
- 256 CPP. ↩︎
- Rapp. de la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’Homme, 40ème session, point 3 de l’ordre du jour 25 février-22 mars 2019, p.6. ↩︎
- 706-113, D47-19 CPP. ↩︎
- D404 CPP. ↩︎
- M. HERZOG-EVANS, Droit pénitentiaire , Dalloz action, 2019, n°3444.01 et s., p. 1068 et s. ↩︎
- I. GALLMEISTER, « Etat et capacité des personnes », rép. civ., 2016, n°135 et s. ↩︎
- E. PECQUEUR, « Sort des majeurs protégés dans la réforme », AJ Fam. 2019, p. 266. ↩︎
- C. DE BEAUREPAIRE, « La vulnérabilité sociale et psychique des détenus et des sortants de prison », Mauss, vol. 40, n°2, 2012, p. 125-146. ↩︎
- Crim. 11 déc. 2018, no 18-80.872, cit. préc. ↩︎
- M. HERZOG-EVANS, Droit pénitentiaire , Dalloz action, 2019, op. cit., n°2232.11 et s., p. 463 et s. ↩︎
- M. HERZOG-EVANS, Droit de l’exécution des peines , 2016, Dalloz action, n°213.11 et s. p. 273 et s. ↩︎
- Ibid, n°213.47. ↩︎